Le Rassemblement National maintient son avance
Les intentions de vote pour les élections européennes restent stables par rapport à notre dernière enquête du 4 mai.
Aucune dynamique n’est à signaler ; la liste du Rassemblement National continue de faire la course en tête, avec 29,5% d’intentions de vote, loin devant Renaissance, stable à 15,5%. La liste conduite par Jordan Bardella puise dans tous les électorats pour élargir son socle : 37% des électeurs d’Eric Zemmour disent vouloir voter pour le RN aux européennes, mais également 17% des électeurs de Valérie Pécresse ainsi que 10% des électeurs d’Emmanuel Macron.
C’est notamment dans l’électorat retraité que le RN progresse fortement puisqu’il est aujourd’hui assez nettement en tête chez les plus de 65 ans.
La liste PS / Place Publique conduite par Raphaël Glucksmann est stable également, avec 13% d’intentions de vote, consolidant sa 3eme place, au détriment notamment des Ecologistes qui demeurent quant à eux à 6% d’intentions de vote. Et pour cause : un électeur sur deux de Yannick Jadot en 2022 déclare vouloir voter cette fois-ci pour la liste PS.
La France Insoumise est en légère progression, à 8,5% (+0,5) et consolide également sa 4eme place. Son noyau dur électoral semble particulièrement bien mobilisé puisque 75% des électeurs LFI se disent sûrs de leur choix. Prudence
toutefois, l’électorat insoumis étant également un des plus sujets à l’abstention du fait de sa moyenne d’âge et de la composante populaire de son électorat.
Les Républicains retrouvent un peu d’oxygène avec une légère hausse de 0,5%, qui leur permet de dépasser Reconquête, et de s’éloigner, avec un score estimé à 6,5%, du seuil critique des 5%.
La sécurité et l’immigration au cœur des motivations de l’électorat de droite
A un mois des élections européennes, nous avons tenté de cerner les motivations des électeurs. La question ne repose pas tant sur leurs préoccupations premières, dont on sait que le pouvoir d’achat arrive régulièrement en tête mais sur leurs motivations premières : quel sujet comptera le plus pour eux au moment de voter ? Le moins que l’on puisse dire est que la question européenne semble secondaire dans l’orientation du choix des sondés.
En effet, c’est la sécurité qui arrive en tête des motivations pour 26% des électeurs. Et c’est au sein de l’électorat RN que cette préoccupation est la plus décisive dans le vote, avec 47% de citations.
Toutefois, cette préoccupation est assez transversale. Elle est citée par 32% des Révoltés, un cluster rupturiste qui a voté à plus de 70% pour Jean-Luc Mélenchon en 2022 mais également par 29% des Sociaux-Républicains, un cluster du centre «mou », peu enclin à la radicalité.
La deuxième motivation des sondés est l’immigration, citée par 15% des sondés. Une préoccupation plus ancrée à droite que la sécurité. C’est ainsi la motivation première de 60% des électeurs Reconquête mais également la motivation première de l’électorat LR, à 36%. C’est aussi la motivation première de 28% des électeurs RN. Ces résultats démontrent à quel point, l’électorat des droites, est aujourd’hui sensible à cette question, et par là même, est en concurrence pour séduire un électorat qui partage les mêmes préoccupations.
Dans le même temps, les autres électorats : PS, LFI, Renaissance et Ecologistes ne citent jamais l’immigration comme étant une motivation de leur vote.
La question européenne au coeur des motivations de l’électorat de centre-gauche
Pour l’électorat Renaissance, c’est la construction européenne et la guerre en Ukraine qui constituent les principales motivations du vote de leurs électeurs, cités respectivement par 31% et 15% d’entre eux.
Des préoccupations assez proches de l’électorat PS : 25% d’entre eux citent ainsi la construction européenne comme motivation première de leur vote.
La motivation principale des électeurs insoumis est la lutte contre les inégalités sociales, citée par 28% des sondés souhaitant voter pour la liste de Manon Aubry. La préoccupation sociale semble centrale au sein de l’électorat insoumis.
C’est moins le cas chez les Ecologistes et chez les électeurs socialistes, davantage motivés par la question climatique ou par le sujet de l’élection, c’est-à-dire la question européenne et la guerre en Ukraine, véritables préoccupations de ces électeurs de gauche « modérée ».
Notons que le conflit au Proche-Orient, qui est au coeur de l’attention médiatique durant cette campagne, n’est citée que par 2% des sondés comme étant leur principale motivation électorale. Il n’y a qu’au sein du cluster des Multiculturalistes que cette question semble relativement importante, citée par 12% d’entre eux comme étant leur principale
préoccupation, loin derrière les inégalités sociales ou l’écologie.
Les européennes : un vote sanction pour un électeur
macroniste sur cinq
Une partie des difficultés de la liste conduite par Valérie Hayer pour Renaissance dans cette campagne peut s’expliquer par le regard critique porté d’une partie importante de l’électorat à l’égard du bilan d’Emmanuel Macron.
Ainsi, 48% des électeurs disent vouloir exprimer leur opposition au Président et à son gouvernement par ce vote aux européennes. 8% vont utiliser leur bulletin pour manifester à l’inverse leur soutien au gouvernement. Tandis que 44% des sondés indiquent que leur vote ne servira pas à manifester un soutien ou une opposition au Président et à son
gouvernement.
Pour expliquer le faible score de Renaissance, il convient de souligner que 21% des électeurs d’Emmanuel Macron en 2022 souhaitent utiliser leur bulletin pour manifester leur opposition à l’action du gouvernement. La réforme des retraites, tout comme la loi immigration ont crispé une partie de l’électorat « macroniste », notamment parmi les clusters de centre-gauche.
C’est ce décalage entre l’offre politique du second quinquennat et la demande d’une partie de l’électorat qui explique que 46% des « Sociaux-Démocrates » et 40% des « Progressistes » souhaitent exprimer un « vote sanction » à l’égard du Président et de son gouvernement, quand bien même, ceux-ci avaient voté à presque 50% pour Emmanuel
Macron il y a deux ans.

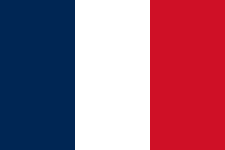 Clusters français
Clusters français Clusters españoles
Clusters españoles Clusters belges
Clusters belges Clusters italiani
Clusters italiani Deutsche Cluster
Deutsche Cluster Clusters foot
Clusters foot



