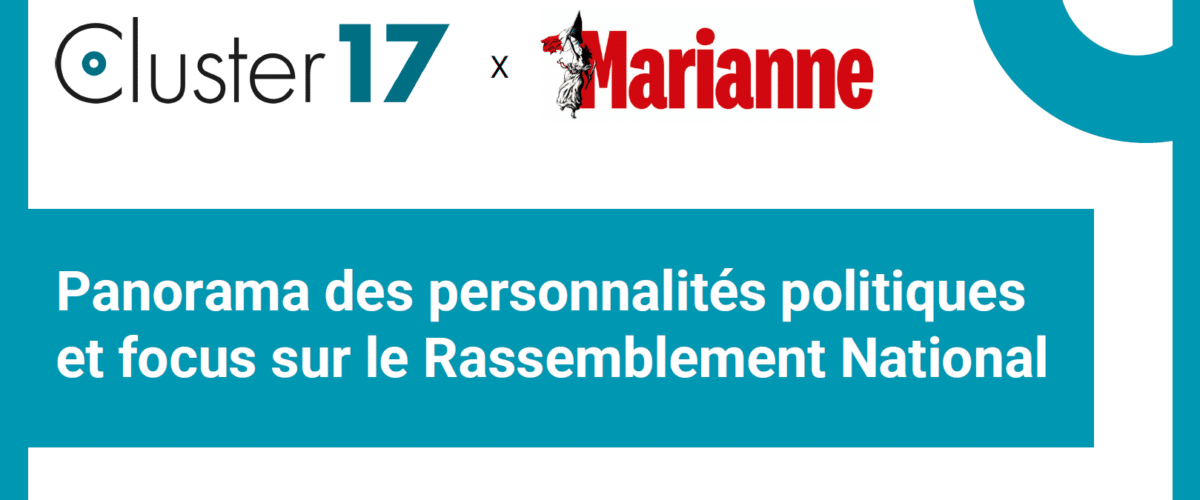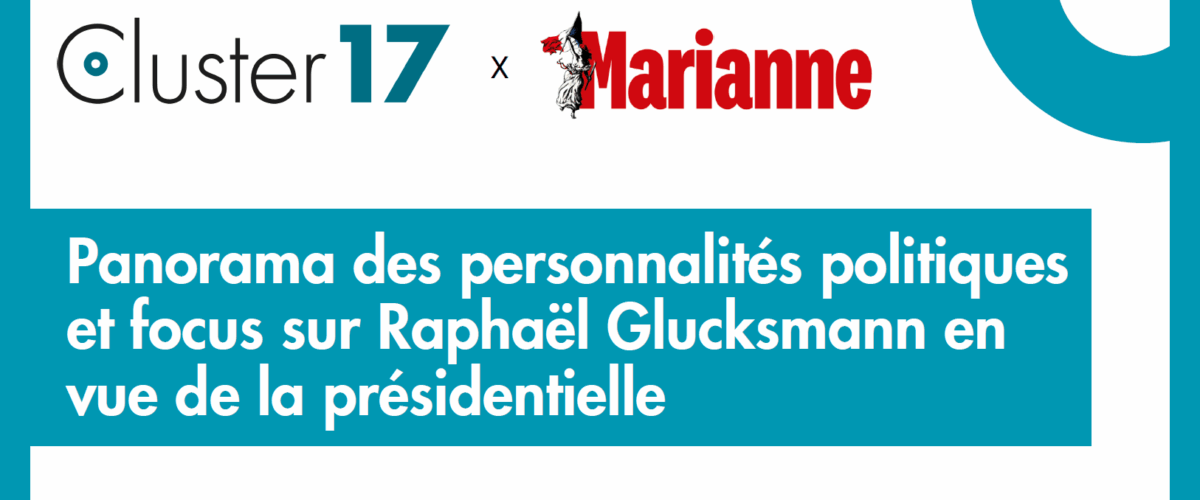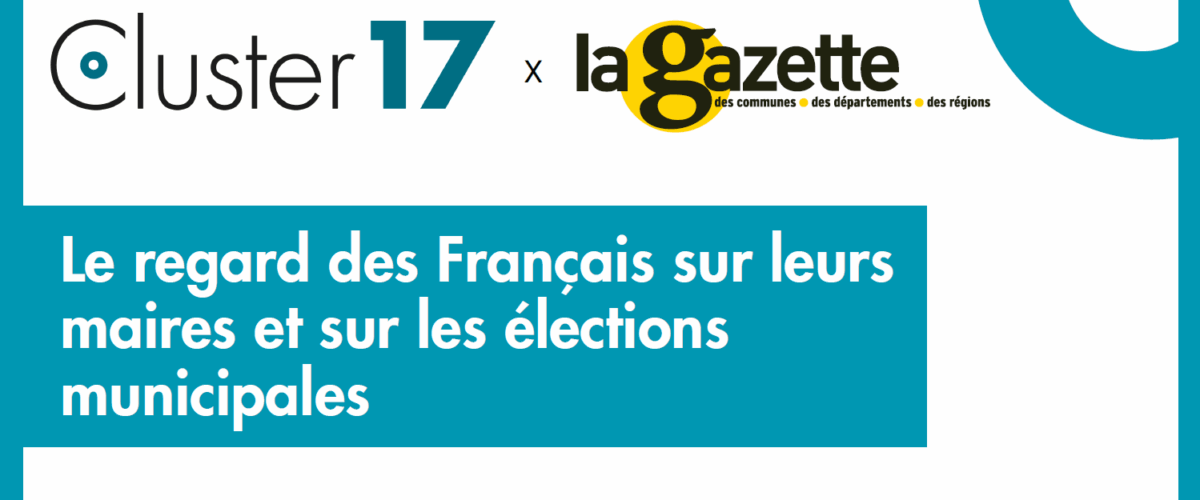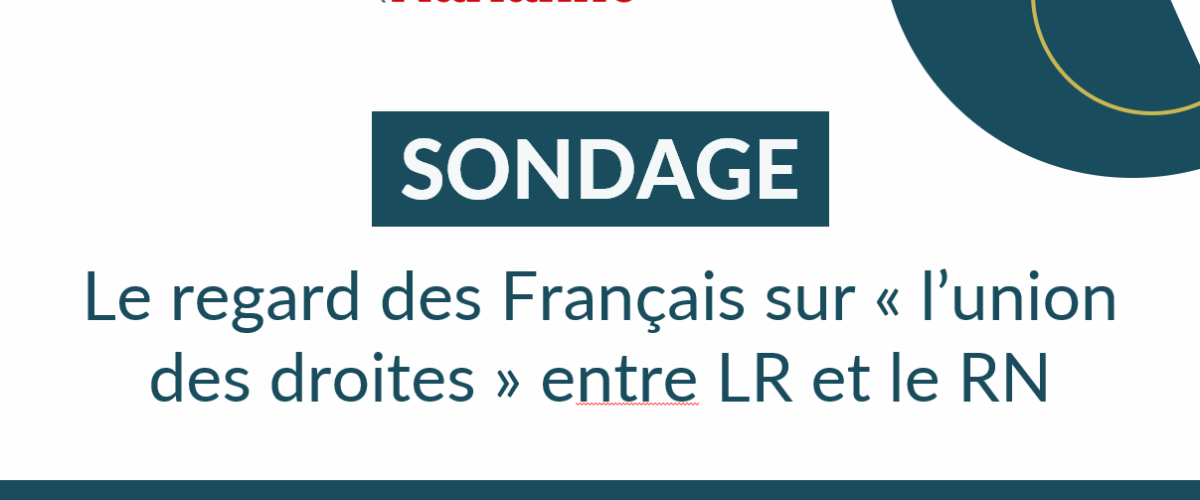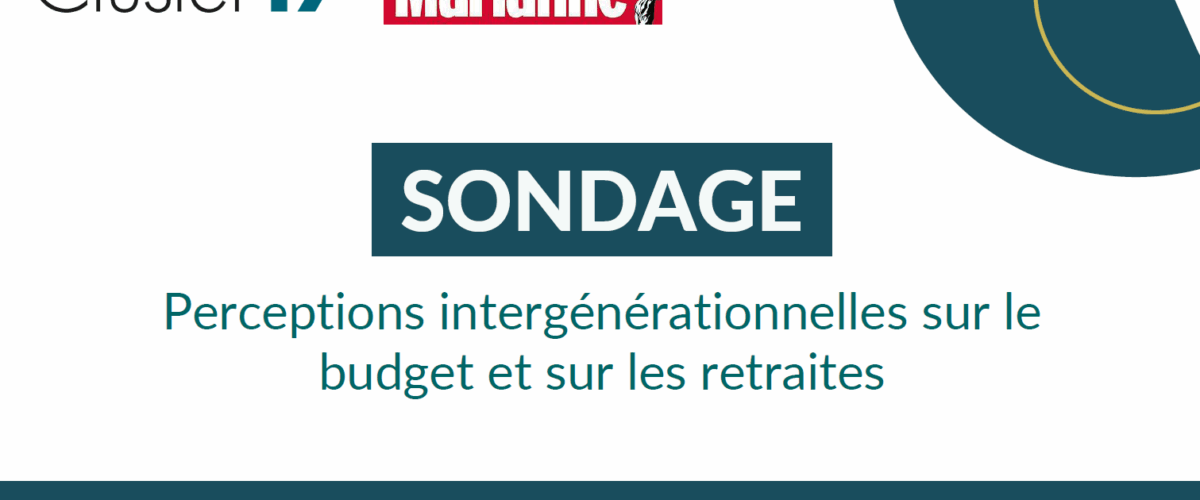Baromètre de l’opinion publique européenne pour Le Grand Continent (vague 5) : Trump et le nouveau clivage géopolitique en Europe
Cluster17 publie la 5e vague de son Baromètre de l’Opinion publique européenne, menée auprès de 7 498 Européens issus de 7 pays de l’Union européenne (Allemagne, France, Italie, Espagne, Pologne, Belgique et Danemark). Après avoir proposé une analyse des points essentiels à retenir du baromètre à l’échelle des pays, les tris croisés par pays en France, en Italie et en Allemagne révèlent comment Donald Trump restructure l’espace politique européen, en unissant contre lui les progressistes et en divisant les droites conservatrices.
En un an d’administration Trump, les représentations géopolitiques des Européens connaissent un basculement net : les États-Unis, longtemps perçus comme un allié structurel, peuvent désormais aussi être envisagés comme une source de menace. 81 % des Européens considèrent qu’une intervention militaire américaine au Groenland constituerait un « acte de guerre contre l’Europe », et 63 % se déclarent favorables à l’envoi de troupes européennes en posture défensive. Plus encore, 21 % jugent désormais qu’une guerre directe avec les États-Unis est probable dans les années à venir, un niveau supérieur à celui observé pour la Chine ou l’Iran, et qui a doublé en quelques semaines.
Cette séquence ouvre la possibilité d’un nouveau clivage politique structurant en Europe, centré sur la relation à l’Amérique de Trump. Dans les trois pays étudiés (France, Italie, Allemagne), le Président américain est majoritairement perçu comme un « ennemi de l’Europe » : en France, 55 % des répondants le qualifient ainsi, contre 7 % seulement qui le voient comme un « ami ». Mais surtout, l’analyse par électorats montre une différence décisive : les espaces progressistes et modérés convergent massivement, tandis que les droites se fragmentent.
Du côté des gauches et du centre, le consensus hostile est extrêmement solide : en France, entre 85 % et 95 % des électeurs de LFI, des écologistes, du PS et de Renaissance qualifient Trump d’ennemi de l’Europe. À l’inverse, les électorats de droite sont désaccordés : l’électorat RN apparaît quasi tripartite, avec environ 25 % qui qualifient Trump d’ennemi, 20 % qui le voient comme un ami, et plus de la moitié qui refuse de trancher. Chez LR, 41 % le qualifient d’ennemi, mais une part presque équivalente hésite encore. Des divisions analogues sont observées en Italie et en Allemagne chez les droites radicales.
La question démocratique approfondit ce clivage : en France, moins de 2 % des électeurs de gauche et du centre estiment que Trump respecte les principes démocratiques. En Italie, quasiment aucun électeur d’AVS, du PD ou du M5S ne le qualifie de démocrate ; en Allemagne, les électeurs de Die Linke, du SPD et des Grünen sont autour de 80 % à estimer qu’il se comporte comme un dictateur.
Le cadrage de la politique extérieure américaine se restructure lui aussi : chez les progressistes et modérés, l’interprétation d’une politique de « recolonisation et prédation des ressources mondiales » devient largement dominante. Elle est retenue en Allemagne par 96 % des électeurs de Die Linke, 89 % des Grünen et 85 % du SPD ; en France, par 94 % des électeurs LFI, 92 % des écologistes, 90 % des socialistes et 83 % des électeurs Renaissance. Cette vision est partagée, en Italie, par 94 % des électeurs M5S, 90 % d’AVS et 86 % du PD.
Les droites radicales restent l’espace où une lecture « légitime » de la politique américaine demeure possible, mais au prix de divisions nettes. En France, 45 % des électeurs RN et 64 % de Reconquête la jugent « légitime » (contre 40 % et 25 % qui parlent de prédation) ; en Allemagne, l’AfD est presque partagée (43 % « légitime », 40 % prédatrice) ; en Italie, 50 % des électeurs Fratelli d’Italia et 55 % de la Lega retiennent la lecture « légitime », tandis qu’environ un tiers y voit une politique prédatrice.
Sur l’arrestation de Nicolás Maduro, plus de 90 % des électeurs de gauche et du centre, en Italie et en Allemagne, jugent l’action américaine illégale et contraire au droit international. En France, cette vision est surtout réservée à la gauche, les électeurs Renaissance n’étant « que » 73 % à la partager. Sur ce sujet aussi, les électorats conservateurs se montrent davantage divisés, entre ceux qui jugent l’action américaine légitime et ceux qui l’estiment illégale. Les électeurs LR sont par exemple 47 % à opter pour la première vision, contre 36 % pour la seconde et 17 % qui déclarent ne pas prendre position.
Enfin, à l’échelle agrégée, le soutien à l’envoi de troupes européennes au Groenland est majoritaire (66 % en Allemagne, 62 % en France, 61 % en Italie), et on remarque un certain consensus sur le sujet parmi les électorats de gauche et du centre, dans les trois pays étudiés. A l’inverse, les droites radicales sont profondément fracturées (FdI : 42 % favorables, 47 % opposés ; RN : 37 % favorables, 51 % opposés), rendant toute position coûteuse pour leurs leaders.
Retrouvez l’analyse et les résultats complets dans l’article du Grand Continent : https://legrandcontinent.eu/fr/2026/01/28/eurobazooka-trump-clivage-geopolitique/
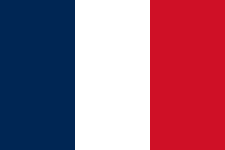 Clusters français
Clusters français Clusters españoles
Clusters españoles Clusters belges
Clusters belges Clusters italiani
Clusters italiani Deutsche Cluster
Deutsche Cluster Clusters foot
Clusters foot