
Sondage pour L’Opinion : Les Français sont pro-business… à leur manière
Dans un contexte marqué par les tensions économiques, les mutations du travail et la montée des préoccupations environnementales, les entreprises occupent une place centrale dans le débat public. Mais comment sont-elles perçues par les Français ? À quelles attentes doivent-elles répondre ? Et quel rôle leur attribue-t-on aujourd’hui ? Ce sondage réalisé pour L’Opinion explore les multiples dimensions du regard porté par l’opinion sur les entreprises, en interrogeant la confiance qu’elles suscitent, la fiscalité qui les concerne, leur rôle social et environnemental, ou encore la figure du chef d’entreprise.
Parmi les sept institutions et organisations testées dans notre sondage, les entreprises occupent une position médiane en matière de confiance. Elles obtiennent une note de 5,6 sur 10, un score qui grimpe logiquement à 7 sur 10 chez les artisans, commerçants et chefs d’entreprise, mais chute à 4,5 sur 10 chez les étudiants. L’armée (7/10), l’hôpital public (6,6) et l’École (5,8) forment le trio de tête, nettement devant l’État (4,4), les syndicats (3,5) et les partis politiques (3,1).
Un point intéressant émerge à propos des impôts et des charges payés par les entreprises, ainsi que des aides publiques qu’elles perçoivent. Une majorité des répondants (56 %) estime que les entreprises françaises sont trop imposées, contre 37 % qui ne partagent pas cet avis. Mais ils sont également 57 % à considérer que ces mêmes entreprises reçoivent trop d’aides publiques. Si ces deux jugements peuvent sembler contradictoires, ils traduisent peut-être une défiance plus générale à l’égard de l’intervention de l’État dans l’économie, qu’il s’agisse de fiscalité ou de subventions. Dans cette perspective, les entreprises devraient être libres d’agir sans contrainte, afin de maximiser leur performance économique.
Dans le détail, les prises de position sont fortement marquées politiquement. Les électorats d’extrême droite, de droite, et dans une moindre mesure du centre, sont très majoritairement convaincus que les entreprises paient trop d’impôts et de charges. Aux dernières élections européennes, c’était le cas de 92 % des électeurs de Reconquête, 86 % de ceux de LR, et 81 % de ceux du RN. À l’inverse, les électorats de gauche sont bien moins nombreux à partager ce point de vue : seuls 7 % des électeurs LFI, 10 % des écologistes et 27 % des électeurs PS/PP le pensent.
Concernant les aides publiques, les clivages entre électorats sont moins marqués, mais les résultats par cluster sont plus révélateurs. Trois des quatre groupes où les membres considèrent le plus massivement que les entreprises reçoivent trop d’aides sont parmi les plus progressistes : les Révoltés (90 %), les Multiculturalistes (86 %) et les Solidaires (86 %). Le quatrième, les Sociaux-Patriotes (80 %), est un cluster conservateur sur le plan culturel, mais socialement et économiquement protectionniste, composé d’individus aux revenus modestes, souvent issus des classes populaires. À l’opposé, les clusters Conservateurs (35 %), Anti-Assistanat (37 %) et Libéraux (40 %), plus favorables au privé et au monde de l’entreprise, sont ceux qui rejettent le plus l’idée d’un excès d’aides publiques.
Sur la question des normes encadrant l’activité des entreprises, un consensus assez fort se dégage : deux tiers des Français (66 %) estiment qu’il y en a trop, contre 13 % qui jugent leur volume adéquat et 8 % qui pensent qu’il n’y en a pas assez. Là encore, une nette fracture oppose les électorats de droite, largement convaincus de l’excès de normes, et ceux de gauche, plus nuancés. Seuls deux clusters, les plus progressistes — les Multiculturalistes (40 %) et les Solidaires (37 %) — comptent une majorité relative de membres jugeant la quantité de normes actuelles insuffisante. Tous les autres estiment qu’il y en a trop, en particulier les Anti-Assistanat (99 %), les Identitaires (99 %) et les Sociaux-Patriotes (92 %).
Lorsque l’on demande aux Français de choisir entre la performance économique des entreprises et le respect des normes sociales et environnementales, les avis sont partagés. 51 % privilégient la compétitivité économique, tandis que 44 % accordent la priorité aux engagements sociaux et écologiques. Ce clivage se retrouve sous une autre forme lorsqu’il s’agit de définir le rôle principal d’une entreprise : « créer de l’emploi » arrive en tête (37 %), suivi de « contribuer au progrès social » (23 %).
Dans la même logique, 12 % des répondants citent le renforcement de la compétitivité comme rôle principal, et 9 % la réduction de l’impact environnemental. De manière assez logique, les générations les plus jeunes accordent davantage d’importance au rôle social et environnemental des entreprises, tandis que les plus âgées privilégient les objectifs économiques. Ainsi, 35 % des 25-34 ans et 32 % des 18-24 ans estiment que l’entreprise doit avant tout contribuer au progrès social, contre seulement 13 % des 65-74 ans et 21 % des 75 ans et plus.
Interrogés sur la question du pouvoir, 49 % des Français estiment que les dirigeants de grandes entreprises en détiennent davantage que le Président de la République, contre 36 % qui pensent l’inverse. Ce sentiment est particulièrement marqué chez les professions intermédiaires (60 %), les employés (55 %) et les ouvriers (53 %). En revanche, les artisans, commerçants, chefs d’entreprise (48 %) et les étudiants (47 %) penchent plutôt en faveur du Président.
Malgré cette perception, une majorité (52 %) considère que les dirigeants de grandes entreprises doivent avoir voix au chapitre dans le débat public. C’est notamment le cas des électeurs de Reconquête (78 %), du RN (73 %) et de LR (72 %). Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que les Français souhaitent voir ces dirigeants aux plus hautes fonctions : 63 % rejettent l’idée selon laquelle ils gouverneraient mieux le pays. Les plus sceptiques sont les jeunes de 18 à 24 ans (88 %).
Enfin, une tripartition intéressante apparaît sur la question du temps de travail. Trois visions du rapport au travail et au temps libre se dessinent : 32 % des Français aimeraient travailler moins, quitte à gagner moins ; 32 % préfèrent travailler davantage pour gagner plus ; et 30 % ne se prononcent pas sur ce choix. L’opinion des individus sur cette question semble orientée très fortement par le système de valeurs des individus. Les électeurs appartenant aux clusters progressistes et de gauche sont les moins favorables à cette idée de travailler plus pour gagner plus, quand au contraire les individus aux opinions plus marquées à droite sont davantage favorables à cette idée qui fut centrale dans le programme de Nicolas Sarkozy.
L’étude complète :
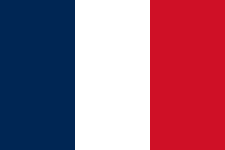 Clusters français
Clusters français Clusters españoles
Clusters españoles Clusters belges
Clusters belges Clusters italiani
Clusters italiani Deutsche Cluster
Deutsche Cluster Clusters foot
Clusters foot